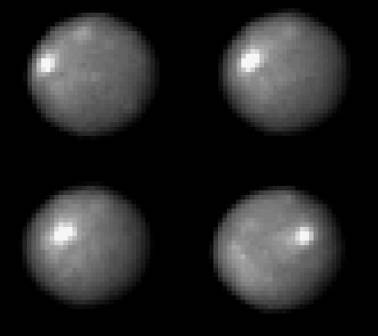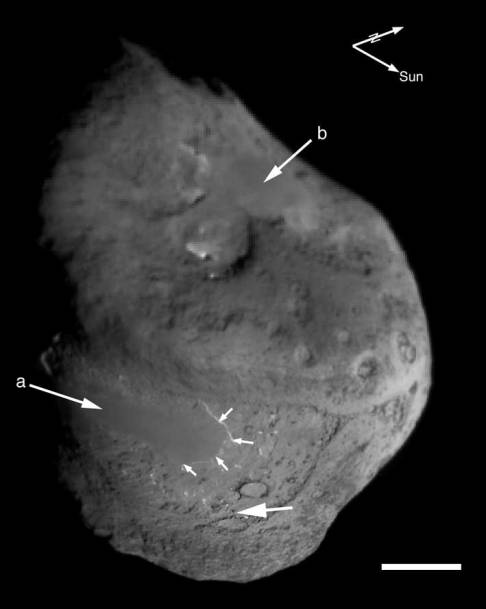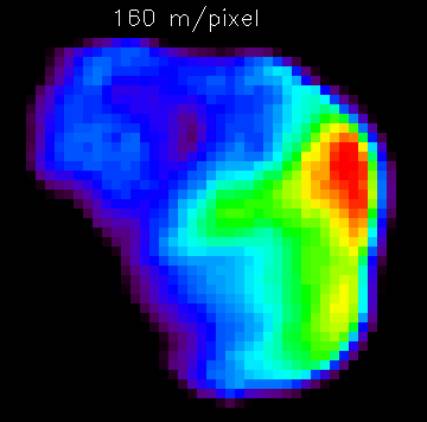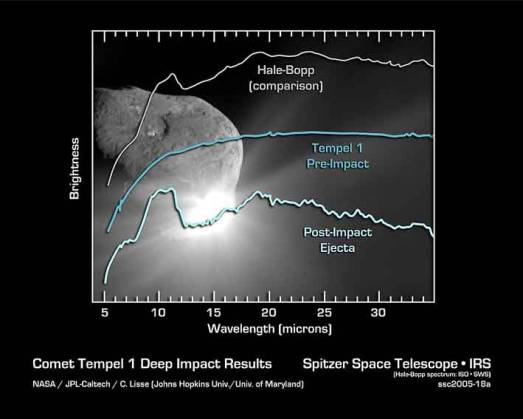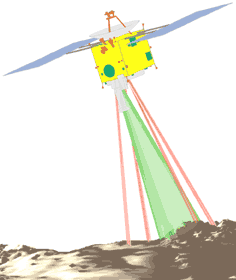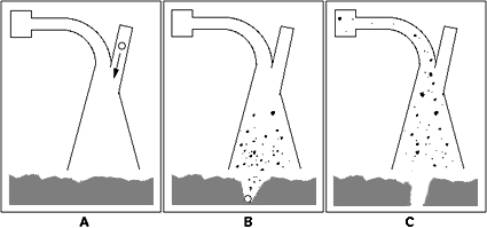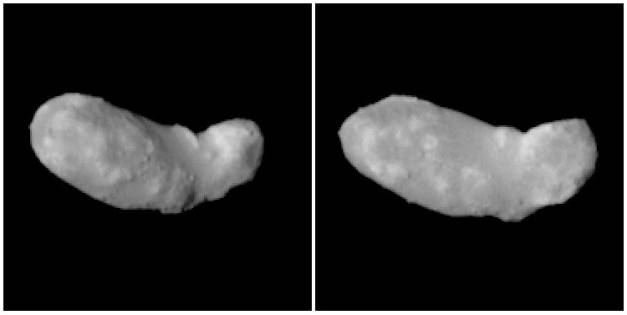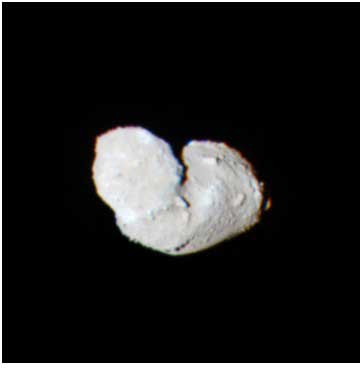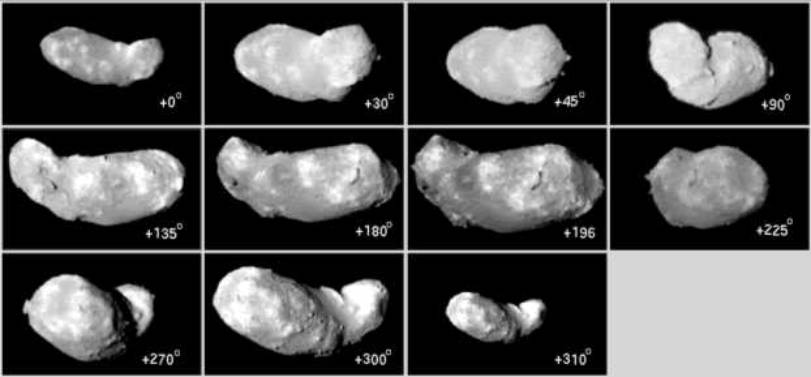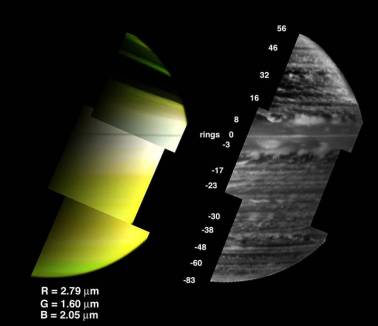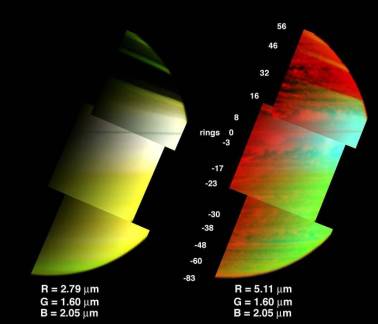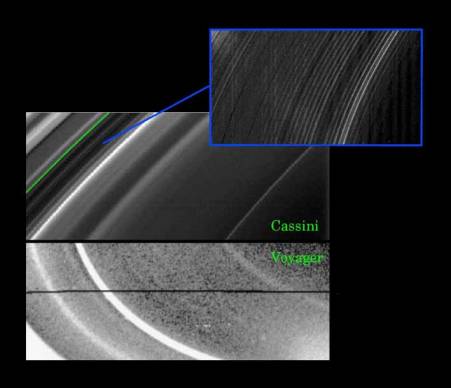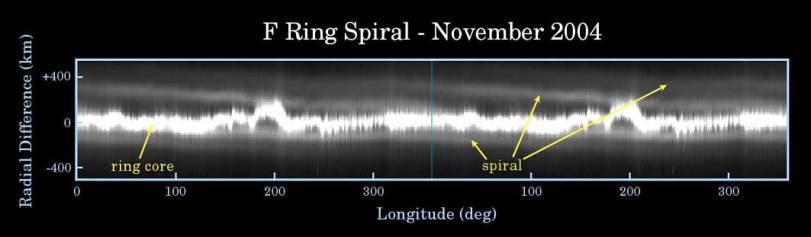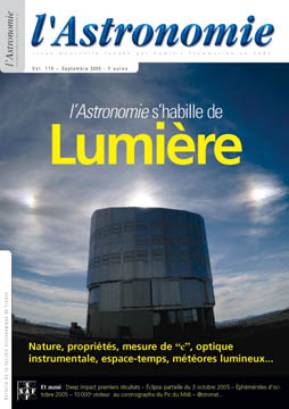LES ASTRONEWS.de planetastronomy.com:
Mise
à jour : 16 Septembre 2005
Calendrier
Conférences et Évènements : ICI
Astronews
précédentes : ICI Infos Dernière Minute ICI
ARCHIVES
DES ASTRONEWS
Sommaire de ce
numéro :
qLes
ondes gravitationnelles : CR de la conférence de Alain Brillet à l'IAP.
(16/09/2005)
qÉnergie sombre et Univers
: Espérance de vie : 20 Milliards d'années ! (16/09/2005)
qLe sursaut le plus
éloigné dans le temps et dans l'espace! (16/09/2005)
qCérès : Une nouvelle
vue du premier astéroïde. (16/09/2005)
qDeep Impact :
Retour sur impact. (16/09/2005)
qHayabusa : Itokawa
en vue, ce n'est pas du chinois, c'est du japonais!
(16/09/2005)
qCassini Saturne :
Atmosphère, atmosphère… (16/09/2005)
qCassini-Saturne : Du
nouveau sur les anneaux. (16/09/2005)
qMagazine conseillé :
"La Lumière fut" avec l'Astronomie du mois de Septembre!
(16/09/2005)
ÉNERGIE SOMBRE ET
UNIVERS : ESPÉRANCE DE VIE : 20 MILLIARDS D'ANNÉES ! (16/09/2005)
L'Univers
ne fait pas assez de bébés
(galaxies) d'après une étude de l'Université d'Édimbourg. En effet c'est la
conclusion d'une analyse de la lumière de 40.000 galaxies.
Comment en est on
arrivé là?
Il faut revenir
sur la composition de l'Univers telle qu'on l'envisage aujourd'hui.
Faire donc le
bilan matière, en fait comme d'après Albert matière et énergie sont deux
équivalents, il faut étudier le bilan énergie/matière de notre Cosmos.
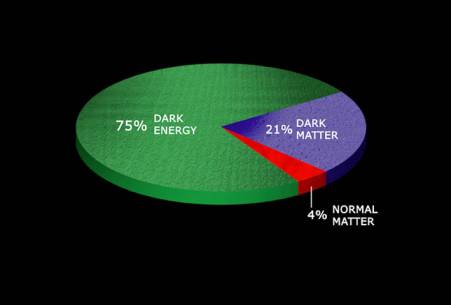 Nous
(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et
galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,
triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on
appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons
neutrons électrons).
Nous
(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et
galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,
triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on
appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons
neutrons électrons).
En effet, on s'est
aperçu que les galaxies ne tournaient pas à la bonne vitesse et que donc il y
avait à proximité de celles-ci d'immenses réservoirs de
matière de type inconnue et qu'on a baptisé poétiquement matière sombre
ou noire (an anglais dark matter). De même l'effet de lentilles
gravitationnelles par cette matière "invisible" nous rend compte de
sa réelle présence. Celle-ci occupe approximativement 20% de l'Univers.
Ce n'est pas tout,
on sait depuis la glorieuse époque (1930) de Edwin Hubble que l'Univers est en
expansion, mais on est certain maintenant (observation des super nova Ia , nos
chandelles standard ou étalons de lumière parsemant l'Univers et qui sont plus
éloignées que prévu!) que cette expansion s'accélère
depuis quelques 7 milliards d'années, comme obéissant à une force répulsive (ou
antigravité) que l'on ne connaît pas et qui ne serait active qu'à des distances
galactiques.
De même lorsque
l'on s'intéresse à la "courbure" de l'Univers et qu'on la mesure
(satellite WMAP par exemple) on s'aperçoit qu'il est pour ainsi dire
"plat" ou euclidien; ceci nous conduit à penser que seule la matière
sombre NE PEUT PAS "courber" l'espace de cette façon, il y a donc
autre chose "là bas", la matière sombre et ordinaire ne comptant que
pour ¼ dans l'effet sur la courbure.
C'est ainsi qu'on
a introduit la notion d'énergie sombre ou noire (dark energy) et qui constitue
les ¾ de l'Univers.
Il est à remarquer
que matière sombre et énergie sombre sont aujourd'hui du même ordre de grandeur, aucune de ces deux formes
n'est fondamentalement supérieure à l'autre , pourquoi? Hasard? Le passé a été
dominé par la matière, le futur sera dominé par l'énergie, pourquoi sommes nous à la croisée des chemins? Restons
bien humble devant ce mystère.
Cette énergie
noire est souvent assimilée à la fameuse constante
cosmologique L d'Einstein, introduit par celui ci en 1917
afin de rendre ses équations de
la relativité générale plus conformes à ce qu'il croyait (univers statique).
Une remarque à
propos de cette constante introduite par Einstein. Notre ami Albert comme la
plupart des astrophysiciens de l'époque pensait à un univers statique, or ses
fameuses équations menaient à un Univers en expansion, alors il ajouta
simplement un terme négatif (répulsif) afin de compenser l'expansion et arriver
à un Univers stable.
Pas de chance
quelques années plus tard Hubble mit en évidence la fuite des galaxies et
Einstein prit sa gomme pour supprimer cette constante maintenant gênante.
En fait on pense
maintenant la réintroduire (les intuitions d'Albert étaient certainement aussi
géniales) en changeant son signe afin de lui donner le rôle principal car
l'expansion s'accélère.
Comment connaît on
les différentes proportions de ces composants, tout "simplement" (ce
n'est pas simple du tout en fait) en les pesant, grâce par exemple au satellite
WMAP et en étudiant la répartition des fluctuations du CMB on a une idée de la
"courbure" de l'Univers qui est influencée par la matière/énergie.
L'univers et son
destin est déterminé par sa "courbure"
, il peut être ouvert (sphère) ou positif ; plat (ou euclidien) ou nul, ou fermé (hyperbole) ou négatif.
Cette courbure est
déterminée par la DENSITÉ DE MATIÈRE ET D'ÉNERGIE contenue.
Pour une certaine
densité appelée densité
critique, il est plat, si la densité totale est supérieure il est fermé, si
elle est inférieure il est ouvert.
On peut écrire
mathématiquement cette composition en introduisant les densités normalisées
(par rapport à cette densité "critique") correspondantes.
Notation :
b=baryonique ; dm : matière sombre ; lambda : énergie sombre
Wb + Wdm + WL = 1
C'est le fait que
l'Univers soit en expansion accélérée à cause de l'influence de l'énergie noire
qui rend sa dilution inéluctable et sa durée de vie limitée.
Le Dr Alan Heavens (un nom
prédestiné, cela veut dire Ciel en anglais!!) de l'Université d'Édimbourg a
même pronostiqué sa fin pour dans approx 20 milliards d'années.
Il faut quand même
être prudent car on a notre portée uniquement que ce que l'on voit (la matière
baryonique visible) et on ne sait pas grand chose sur la répartition de ce qui
est invisible.
Afin d'affiner ces
mesures, les astrophysiciens ont besoin d'étudier un million de galaxies au
moins, ce qui devrait être fait dans les 10 prochaines années.
Cela va peut être
susciter des vocations parmi nos jeunes étudiants.
Mais comment peut
on mettre en évidence cette énergie sombre?
Des
scientifiques des Berkeley Labs et du Dartmouth College pensent être sur
une piste.
Ils ont mis sur
pied un ensemble d'expérience au sein du JDEM (Joint Dark Energy Mission) de la
NASA et du DOE (Département de l'Énergie).
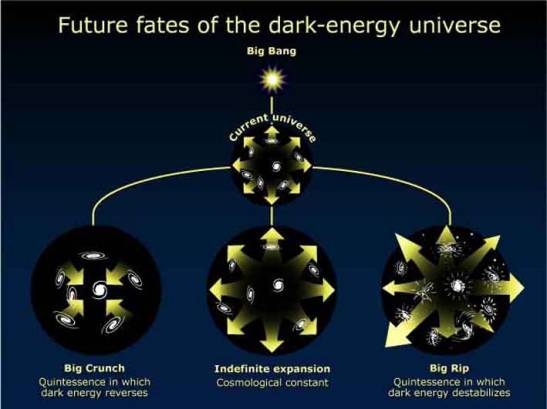 La base de cette mission est une sonde
appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer
entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre
plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit
continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big
Crunch).
La base de cette mission est une sonde
appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer
entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre
plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit
continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big
Crunch).
(Dessin des
scénarios possibles par la NASA)
Comme cette
énergie inconnue forme la plus grande partie de l'Univers, c'est elle qui va
déterminer donc notre destin, d'où l'importance des ces mesures.
Le projet SNAP consiste en un télescope de 2m
placé en orbite afin de s'intéresser uniquement au SN Ia et devrait permettre
d'éliminer certains scénarios. Voir absolument toutes les pages de leur site.
POUR
ALLER (VRAIMENT) PLUS LOIN :
Conférence
d'Hubert Reeves à La Villette sur matière et énergie sombres.
Un bijou en
anglais par le professeur Sean Caroll de l'Université de Chicago, une
présentation simple et claire sur notre
Univers et sa composition (cela s'appelle "the preposterous
Universe", littéralement, l'Univers absurde, mais vous verrez que ce n'est
pas si absurde que cela) c'est facile à lire même si vous ne dominez pas
l'anglais, ne réfléchissez pas allez-y faites moi confiance, vous ne le
regretterez pas.
The Universe Adventure (anglais) :
génialement simple pour comprendre l'origine et la composition de l'Univers,
comprend aussi des quiz pour voir si vous suivez!
L'énigme
de la matière noire par Alain Bouquet.
La
matière noire par l'ENS de Lyon.
C'est quoi la
matière noire par IN2P3 de Montpellier (6 pages format pdf).
Les secrets
de la matière noire de Futura Sciences :
Univers
et big bang par notre ami JC Boulay : un classique clair à voir et revoir.
Thierry Lombry de
Luxorion n'est pas en reste avec son chapitre sur la
matière et l'énergie sombres.
De Lyon, excellent
sur la
matière noire.
L'univers
aura-t-il une fin par les astrofiles
L'énergie
sombre : le coté obscur de l'Univers : par votre serviteur dans un
astronews précédent.
Le Télescope Hubble
et la constante cosmologique
PUS COMPLEXE :
The cosmic
triangle par l'Université Cornell.
Dark energy dominates the universe by University of Bonn : très bien fait,
excellent résumé de la situation.
The
cosmological constant is back : 10 pages pdf par Michael Turner de
l'Université de Chicago, l'inventeur du terme "dark energy" :
Astroparticules
et cosmologie IN2P3. (21 pages
format pdf). Très bon.
Cosmologie par Ned Wright
(anglais) en plusieurs chapitres assez bien documenté, il faut suivre
attentivement.

LE SURSAUT LE PLUS ÉLOIGNÉ
DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE (16/09/2005)
(dessin NASA)
Le 4 Septembre
2005 s'est produit un sursaut gamma d'une distance jusque là jamais égalée,
cette explosion d'une super nova se transformant en trou noir, s'est produite à
12,6 milliards d'années lumière, soit moins de 1 milliard d'années lumière
après le Big Bang.
C'est le satellite
Swift en orbite depuis presque un an (dont
a déjà parlé) qui l'a détecté en premier et a
passé l'information rapidement au réseau de télescopes terrestres permettant au
VLT de l'ESO de
le photographier.
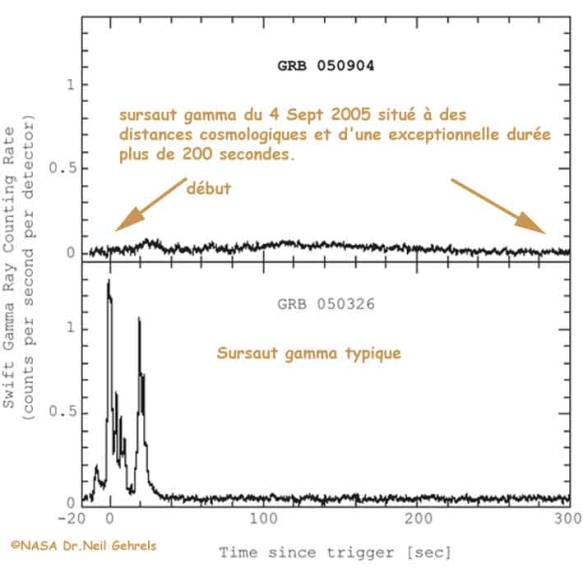 L'intérêt
de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances
cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.
L'intérêt
de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances
cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.
Les
astrophysiciens ont ainsi accès aux premières formations de l'Univers, et vont
essayer de dater la formation des premières étoiles et des premières galaxies.
Ce sursaut gamma a
duré plus de 200 secondes ce qui est assez exceptionnel, il n'a pas été vu dans
le visible mais dans le proche IR signifiant que l'environnement devait être
encombré de poussières galactiques.

CÉRÈS : UNE NOUVELLE VUE
DU PREMIER ASTÉROÏDE. (16/09/2005)
(photo HST)
C'est le 1er
Janvier 1801 que Guiseppe Piazzi par hasard alors que tout le monde était à la
recherche de la planète manquante entre Mars et Jupiter (on était obsédé par la loi de Bode
à l'époque), découvrit dans sa lunette depuis son balcon de Palerme, ce qu'il
prit pour cette planète.
Il la baptisa
Cérès, nom de la déesse romaine de l'agriculture.
Elle faisait en
fait 1000km de diamètre et était bien située vers les 400 millions de km comme
prévu.
Malheureusement on
découvrit peu à peu beaucoup d'autres "planétoïdes" dans cette zone
qui allait devenir la ceinture des astéroïdes. Piazzi devait
déchanter, Cérès n'était pas une planète mais seulement le plus gros des
astéroïdes.
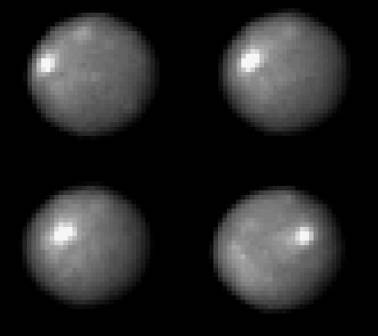 Jusqu'à
présent on avait pas d'images bien claires de Cérès, cela change, le télescope
Hubble s'est consacré il y a peu à celui-ci (267 images en tout) sur une
rotation complète (9h) et a ainsi bien confirmé qu'il était rond et donc peut
être différencié comme notre Terre. On pense
qu'il possède un noyau rocheux, un manteau glacé et une fine couche de
poussières.
Jusqu'à
présent on avait pas d'images bien claires de Cérès, cela change, le télescope
Hubble s'est consacré il y a peu à celui-ci (267 images en tout) sur une
rotation complète (9h) et a ainsi bien confirmé qu'il était rond et donc peut
être différencié comme notre Terre. On pense
qu'il possède un noyau rocheux, un manteau glacé et une fine couche de
poussières.
On espère aussi
trouver beaucoup de glace d'eau en sous sol, car sa densité est de l'ordre de 2
(Terre 5,5) et que l'on en a détecté dans son spectre.
La tache blanche
de l'image n'est pas expliquée, est ce de la glace? On ne sait pas encore.
Cérès est malgré
cette photo très sombre (albédo 0,10), le contraste a été fortement augmenté
afin de la rendre lisible.
On pense que Cérès
est une planète à l'état d'embryon (représente 25% de la masse totale de la
ceinture d'astéroïdes), qui n'a pas pu terminer sa formation due à la présence
de Jupiter (les corps dans la zone des astéroïdes sont pris entre deux feux :
l'attraction du Soleil et l'attraction de Jupiter, dès qu'ils deviennent trop gros
ils se brisent par les forces de marée).
Il faudra attendre
2015 pour avoir plus d'information sur Cérès, une sonde lui est dédié, la mission DAWN.

DEEP IMPACT : RETOUR SUR IMPACT. (16/09/2005)
(Photos NASA/UMD et
Spitzer)
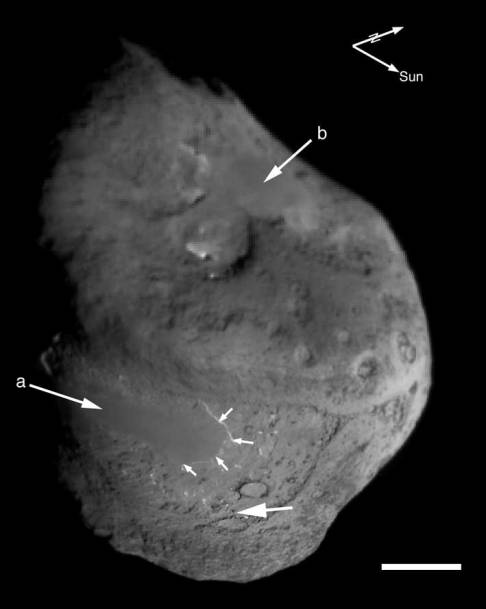 D'après
les scientifiques de la mission et notamment son responsable, Mike
A'Hearn, l'impact a révélé beaucoup plus d'informations surprenantes que prévu.
D'après
les scientifiques de la mission et notamment son responsable, Mike
A'Hearn, l'impact a révélé beaucoup plus d'informations surprenantes que prévu.
Par exemple, la structure même de ce noyau de comète serait
d'une consistance plus fine qu'un tas de talc,
cet ensemble ne tient que par la gravité (qui est quand même très faible, moins
de 10.000 fois moins que la gravité terrestre! Vitesse
de libération
1m/sec : 3,6km/h, si vous éternuez trop fort sur Tempel 1, vous partez dans
l'espace!!).
On a aussi vu clairement ce qui semble être des cratères d'impact (comme sur la photo ci-contre, où
l'impact s'est produit entre les deux cratères du bas là où se trouve la grande
flèche) ce qui n'était pas le cas sur d'autres noyaux de comètes vus de si
près (les cratères aperçus sur les
autres noyaux de comètes sont on le pense, des cratères de dégazage).
La barre blanche représente 1km.
Les zones marquées a et b sont très lisses et nous n'avons pas
encore de bonnes explications pour cela.
Mais une des grandes découvertes, a été de détecter des
molécules à base de carbone dans les éjecta après l'impact. Cela prouve que les
comètes contiennent des éléments organiques et
que selon beaucoup de théories elles auraient pu ainsi semer la vie dans notre
système solaire (et au delà pourquoi pas?), lors d'impacts planétaires. (la
panspermie)
 L'analyse
des données s'est faite en partie par le Dr Olivier Groussin (voir photo) de
l'UMD, Université du Maryland, (mais formé à l'Observatoire de Marseille, LAM).
L'analyse
des données s'est faite en partie par le Dr Olivier Groussin (voir photo) de
l'UMD, Université du Maryland, (mais formé à l'Observatoire de Marseille, LAM).
Il est post doc à l'UMD depuis un an et demi et a passé une
thèse d'astronomie au LAM sur les noyaux cométaires.
Il nous explique sa contribution à la mission Deep Impact :
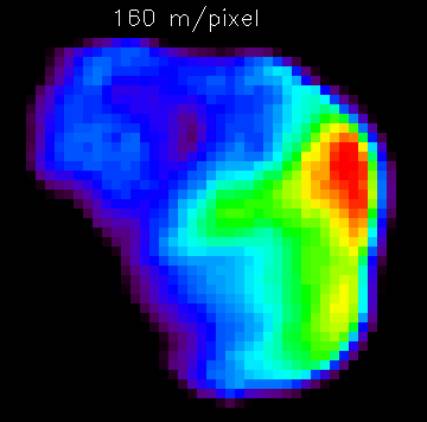 "Ma
participation à la mission Deep Impact comporte plusieurs volets. D'un point de
vue instrumental, j'ai effectué la calibration des cameras de la sonde (HRI et
MRI) et de l'impacteur (ITS), qui nous ont toutes donné des images
fantastiques.
"Ma
participation à la mission Deep Impact comporte plusieurs volets. D'un point de
vue instrumental, j'ai effectué la calibration des cameras de la sonde (HRI et
MRI) et de l'impacteur (ITS), qui nous ont toutes donné des images
fantastiques.
D'un point du vue scientifique, j'ai
développé un modèle pour interpréter les spectres infrarouges du spectromètre
HRI-IR, et je travaille aussi sur les propriétés thermiques et l'activité du
noyau de Tempel 1.
A ce sujet, j'ai réalisé la première carte
de température d'un noyau cométaire [voir image]. La température a la surface
du noyau varie de 260 K a 330 K. L'inertie thermique du noyau est faible.
Cela implique un noyau a faible conductivité
thermique, donc poreux.
Par ailleurs, l'absence de région froide
(inférieure a 200 K) en surface indique que l'activité cométaire (i.e. la
sublimation des glaces d'eau de CO et de CO2) a probablement lieu sous la
surface, dans les premières
couches internes du noyau. "
Un noyau poreux (comme une éponge) et donc très peu conducteur
de la chaleur, voudrait dire que la glace constituant l'intérieur pourrait
rester en l'état depuis l'origine du système solaire.
Cette grande porosité de l'état
de surface risque d'ailleurs de poser des problèmes lors de l'atterrissage de
Rosetta, il ne faudrait pas que l'on s'enfonce dans le sol de la comète.
Ces données ont aussi indiqué la présence (bien entendu) d'eau
vaporisée par la chaleur de l'impact, suivi quelques secondes plus tard par les
raies d'absorption de la glace éjectée du sous sol du cratère.
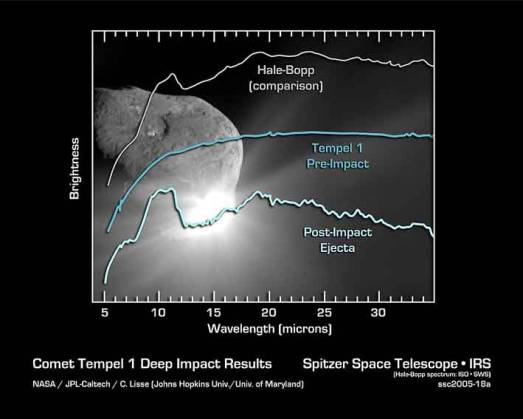 Le
télescope spatial en IR Spitzer a aussi étudié l'impact avec son spectromètre
et nous fournit cette image détaillée. (voir photo ci-contre).
Le
télescope spatial en IR Spitzer a aussi étudié l'impact avec son spectromètre
et nous fournit cette image détaillée. (voir photo ci-contre).
On y voit le spectre IR avant (bleu) et après l'impact ainsi
que le spectre de Hale Bopp pour comparaison.
En étudiant plus en détail ces spectres, on y trouve la trace
de : composés de Fer, argile, carbonates, silicates (olivine), et des
hydrocarbures aromatiques.
On s'éloigne peu à peu de l'image de la boule de neige sale!
Je crois savoir que Mike veut remplacer l'expression
"dirty snowball" (boule de neige sale) par "snowy dirtball"
(boule de saleté neigeuse!), à suivre….
Comment
tous ces composants se
sont retrouvés dans le noyau de la comète est en partie mystérieux, car ce
genre de composants se forment dans un environnement nécessitant de la chaleur,
ce qui n'est pas le cas de ce genre de comètes.
Il a été aussi annoncé à la dernière conférence astronomique de Cambridge (UK ce mois de Septembre 2005)
ces jours ci que le cratère provoqué dans Tempel 1 était de l'ordre de 100m de
diamètre et d'un dizaine de m de profondeur.

HAYABUSA : ITOKAWA EN
VUE, CE N'EST PAS DU CHINOIS MAIS DU JAPONAIS! (16/09/2005)
(Photos et dessins
ISAS et JAXA)
Voilà une petite
sonde dont on a pas beaucoup parlé, c'est une sonde japonaise dirigée vers un
petit astéroïde "japonais" baptisé 25143-Itokawa (anciennement 1998
SF 36) en l'honneur d'un pionnier de l'espace japonais.
Cette cible, un
NEA (géocroiseur) situé actuellement à 300 millions de km de nous, est
relativement petite : 500m dans sa plus grande dimension, période de rotation :
12h.
Cette sonde
portait d'abord le nom de MUSES-C (cela voulait dire Mu Space Engineering
Spaecraft C, Mu était le nom de la fusée et C voulait dire que c'était le
troisième essai) et a été lancée de la base d'Uchinoura le 9 Mai 2003.
Une fois mis sur
la bonne orbite, on a changé son nom en un nom plus poétique :Hayabusa, qui
veut dire faucon en japonais.
PROFIL DE LA
MISSION :
La caractéristique
de cette mission est la présence à bord de moteurs ioniques (comme sur Smart et
sur Deep Space 1). Après approche de l'astéroïde, il est prévu une méthode
originale de retour d'échantillons suite à une série de "Touch and
Go" comme on dit en aviation.
Elle devrait pour
la PREMIÈRE FOIS AU MONDE ramener des échantillons
de cet astéroïde
L’atterrissage une
fois décidé se passe en larguant un marqueur à basse altitude (100m)
Il sert de signal
radar (dessin de gauche) pour un atterrissage en CHUTE LIBRE (faible gravité),
ceci afin d’éviter une contamination avec les carburants chimiques.
Ensuite prise d’échantillons
prévue pour Novembre 2005 (voir dessin de droite) et re-décollage jusqu’à un
nouvel ordre d’atterrissage ailleurs
Une technique
originale pour ramasser des échantillons de la surface : la pichenette!
Une bille lancée
violemment va soulever de la poussière qui avec la faible gravité (cent mille
fois moins que la Terre, vitesse de libération : 0,2m/s!!!) et l’aide d’un aspirateur va aller dans le réceptacle de
réception
Une seconde après
son atterrissage la sonde re-décolle pour un autre site.
Un petit
compartiment scientifique (baptisé Minerva) gros comme une boite de conserves
devrait aussi être largué à la surface de l'astéroïde afin de mesurer la
température et d'autres paramètres. Il devrait être capable de se déplacer en
sautant (pas trop fort sinon…).
Une fois ces
quelques échantillons ramassés, le voyage de retour prend aussi près de 2
ans(été 2007)
Ces échantillons
sont mis dans une capsule étanche qui doit être récupéré par parachute au
dessus de l’océan
Souhaitons bonne
chance à cette extraordinaire mission
Pour le moment, la sonde vient de se mettre
en orbite le 12 Septembre 2005 à 20km de la surface et nous fait parvenir
de superbes photos.
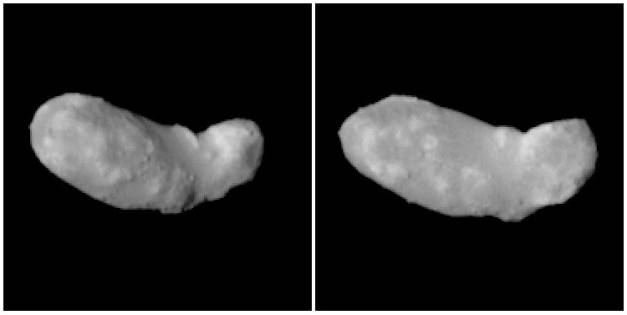
Photo prise le 10 Septembre 2005 à
l'approche de l'astéroïde.
Photo du 12
Septembre 2005 en orbite à 20km de la surface et en couleur au travers de 3
filtres RGB:
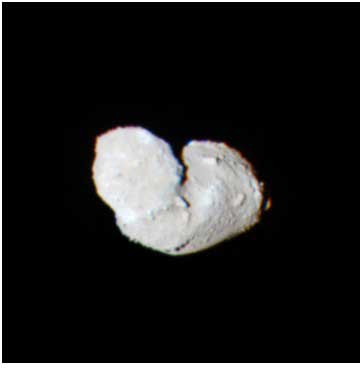
Vue d'une rotation autour de cette
astéroïde.
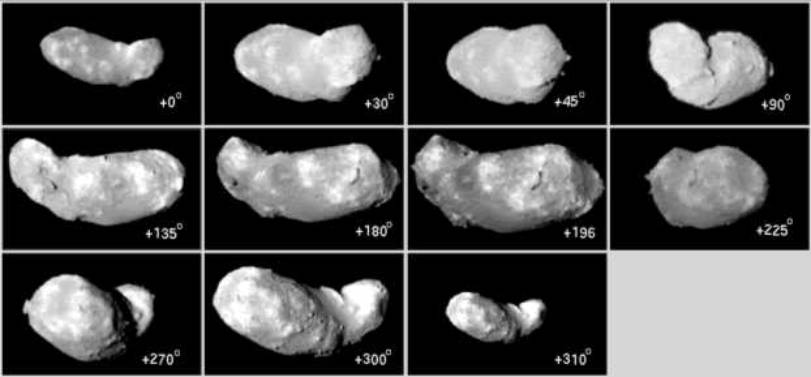
Pas mal pour une
petite mission dont personne n'avait parlé!!!!!!
Voir détails et instruments
de cette mission sur le site des NEO du JPL.
Description
succincte de la mission 1 page pdf en anglais.
Le site
de Hayabusa à l'agence spatiale japonaise JAXA.

CASSINI-SATURNE
:ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE ! (16/09/2005)
(photo NASA/JPL)
Comme vous le
savez, il y a en ce moment à Cambridge en Grande Bretagne, un grand rendez vous
d'astronomie et l'on y parle de Cassini.
De nouvelles et
extraordinaires images des nuages de Saturne ont été diffuées à cette occasion.
|
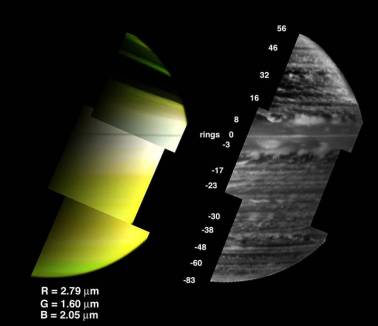
|
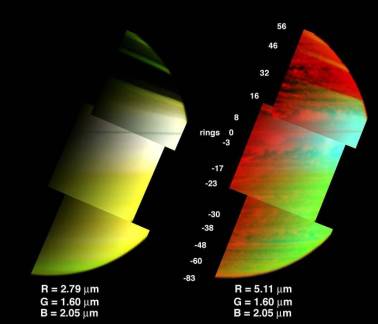
|
|
À droite on voit
les nuages situés 30km sous la couche externe de nuages, ils sont à la
pression de 2 bar. À gauche on voit la couche externe située à 1 bar. Plus
d'explication sur le site de la mission.
Photos prises le 28 Juin 2005 de 1,2 millions de km. À gauche avec : 2.79
micron (red), 1.60 micron (green), et 2.05 micron (blue), à droite à 5,1
micron et en inversion noir/blanc.
|
L'image de
droite correspond à différentes couches dans l'atmosphère de Saturne. Le
rouge représente les couches les plus profondes jamais trouvées (pression 2
bars) sur cette planète, mesure à 5,1 micron. Le vert correspond aux mesure à
1,6 micron montrant les nuages des couches supérieures situés à 1 bar.
Inversion de luminosité pour affiner les détails. Le bleu correspond à une
pression de 0,7 bar dans la très haute atmosphère à 10km au dessus de la zone
nuageuse principale.
Tous les détails
sur le site de la
mission.
|
On s'aperçoit de
la grande diversité de l'atmosphère saturnienne, où les nuages ont pu être
analysés par le VIMS (en visible et IR). Beaucoup sont à 30km sous la couche
principale, ils sont constitués principalement d'hydrosulfure d'ammoniac ou
d'eau, la couche supérieure atmosphérique étant plutôt des nuages d'ammoniaque.
La plus belle
image de phénomènes atmosphériques reste quand même la tempête en forme de
dragon que l'on voit sur cette superbe photo d'un ancien
numéro des astronews.
Comme d'habitude,
vous trouverez toutes les dernières images de Cassini au JPL
Les prochains
survols : http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm
Tout sur les orbites
de Cassini par The Planetary Society; très bon!
Voir liste des principaux
satellites.

CASSINI SATURNE : DU
NOUVEAU SUR LES ANNEAUX. (16/09/2005)
(Photos : NASA/JPL)
En compléments aux
informations publiées dans le dernier
astronews sur les anneaux, voici des nouveautés de Cassini.
Concernant
l'anneau D, le plus proche de Saturne.
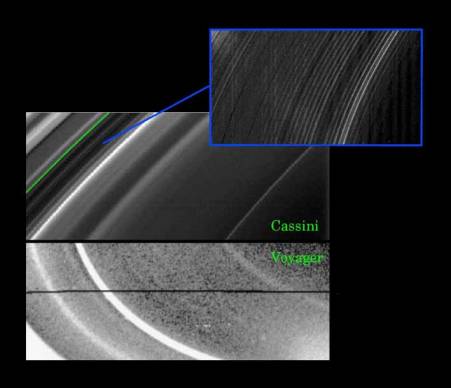
Montage de photos
provenant des missions Voyager (1980) et Cassini (2005), montrant l'évolution
des détails en un quart de siècle.
La photo de
Voyager (en bas) prise d'une distance de 250.000km montre à l'extrême gauche le
bord de l'anneau C puis vers l'intérieur trois annelets de l'anneau D appelés
respectivement de g à dr : D73, D72 et D68.
Les photos de
Cassini ont été prises de 270.000km en Mai 2005 et montrent la même région mais
avec plus de détails.
La ligne verte
marque la limite de l'anneau C
On remarquera le
changement concernant D72 qui n'est plus aussi brillant qu'il y a 25 ans et qui
de plus s'est déplacé vers l'intérieur de 200km.
Dans l'encart
photographique en haut à droite on voit avec une plus grande définition la
structure fine de l'anneau D entre D73 et l'anneau C avec une résolution de 2m
par pixel. On aperçoit parfaitement le phénomène d'ondulations dû certainement
aux perturbations par les différents satellites.
Concernant
l'anneau F :
On amis en
évidence une structure en spirale.
Cassini a mis en évidence un anneau en
forme de spirale qui coure autour de la planète au niveau de l'anneau F.
Ce serait aussi l'influence des
mouvements désordonnés de certaines lunes, et provoquant une certaine
instabilité de cet anneau F.
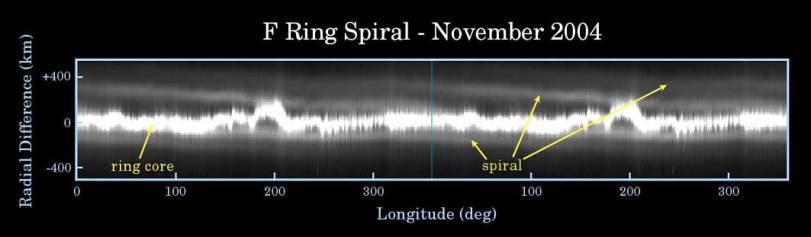
Sur cette photo on a représenté deux
types d'information.
Tout d'abord on voit l'anneau F
développé sur toute sa circonférence (marqué ring core), puis on a indiqué la
présence de la spirale qui débute approximativement 350km au dessus du corps
principal de l'anneau (l'échelle verticale fait +/- 400km) et fait plusieurs
fois le tour, dont on voit les traces sur cette photo (marquées spiral).
On pense que ce structure en spirale
est constitué de particules très légères éjectées du corps central de l'anneau
F.
On est loin d'avoir trouvé une
explication satisfaisante à ce phénomène.
Concernant
l'anneau G :

Cet anneau est très
fin et se trouve à 170.000km du centre de la planète, donc au delà de A et F.
les scientifiques
de la mission ont découvert un arc brillant dans cet anneau très ténu,
ressemblant à celui trouvé par Voyager près de Neptune. Cette arc pourrait être
dû à la présence d'un satellite pas encore découvert.
Voici plus haut,
une séquence de photos prise à 45 minutes d'intervalle, on y voit se déplacer
un arc très brillant le long d'un annelet brillant.
Ces images ont été
prises en lumière polarisée IR le 24 Mai 2005 à une distance de 1,7 millions de
km.
Rapports sur la
conférence de Cambridge concernant Cassini (anglais) :
http://www.spacedaily.com/news/cassini-05zzze.html et
http://www.spacedaily.com/news/cassini-05zzzc.html
http://ciclops.org/view.php?id=1419
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-09/ssi-crn090505.php
http://www.pparc.ac.uk/Nw/dps_rings.asp
Comme d'habitude,
vous trouverez toutes les dernières images de Cassini au JPL
Les prochains
survols : http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm
Tout sur les orbites
de Cassini par The Planetary Society; très bon!
Voir liste des principaux
satellites.

MAGAZINE CONSEILLÉ :
"LA LUMIÈRE FUT" AVEC L'ASTRONOMIE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2005. (16/09/2005)
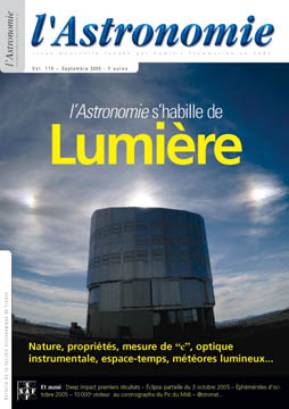
Un
numéro exceptionnel de l'Astronomie la revue de la SAF (Sté Astronomique de
France) sur la Lumière.
Je vais faire des frustrés car vous ne pouvez pas trouver ce
numéro en kiosque, il n'est disponible que pour les adhérents ou au siège de la
SAF. Si vous n'êtes pas membre de la SAF, vous pouvez le trouver soit :
** au siège de la SAF 3, rue Beethoven, 75016 Paris
Tél. +33 (0)1.42.24.13.74 Fax. +33 (0)1.42.30.75.47
Observatoire +33 (0)1.40.46.20.00 Atelier +33 (0)1.40.46.24.98 , détails sur le
site Internet de la SAF.
** à la Maison de l'Astronomie rue de Rivoli à Paris.
Voici le sommaire
de ce numéro :
SOMMAIRE
Éditorial - par
Marie-Claude Paskoff
(Extraits)
C'est
précisément à ce thème, la lumière, que l'Astronomie de ce mois consacre un
volumineux dossier. Y avait-il une meilleure façon de marquer dans votre revue
l'Année mondiale de la Physique ? Comme chacun sait, lumière et astronomie
forment un couple inséparable dont la fécondité n'a pas de limites.
Nous
vous proposons un parcours qui n'a pas la prétention d'être exhaustif sur ce
sujet. Certains regretteront que la théorie quantique des photons n'ait été
qu'évoquée, ou que les conséquences de la théorie de la gravitation sur les
trajectoires lumineuses n'aient pas fait l'objet d'un article... le choix de la
Rédaction a été de rester dans des domaines familiers et fondamentaux. Que nous
apprend la lumière reçue des astres ? Comment est-on parvenu à déterminer la
vitesse de la lumière ? Quel est le rôle de “c” dans la structure de
l'espace-temps ? Comment les lois de l'optique apprivoisent-elles la lumière
dans nos instruments d'observation ? Quels jeux de la lumière dans l'atmosphère
produisent les spectacles féeriques que nous admirons ? Tels sont les grands
chapitres traités. En complément de ce dossier, nous vous invitons à visiter
l'exposition à l'Observatoire de Paris qui débutera bientôt (voir informations
en couverture IV).
Vous
découvrirez à la place habituelle un cadran solaire peu banal utilisant une
lumière bien particulière. Quant aux
Portraits célestes, ils ont été disséminés dans le chapitre consacré aux
phénomènes lumineux atmosphériques. Enfin, vous trouverez dans les
Éphémérides le rappel du rendez-vous
avec la planète Mars à ne pas manquer dans les semaines qui viennent.
Actualité
Deep-Impact en
direct – Les premiers résultats de
Deep-Impact – Les premières roches d’astéroïdes sur Terre
par Marie-Claude
Paskoff, Claude Picard et Anthony Laurent.
Spécial
lumière
**Nature et vitesse de la lumière, de RØmer à Fresnel
par James Lequeux
**La mesure de la vitesse de la lumière
Jean-Louis Bobin
**Vitesse de la lumière et relativité restreinte
par Christian
Magnan
**Le message de la lumière
par Lucette
Bottinelli et Lucienne Gouguenheim
**Phénomènes lumineux dans l’atmosphère
par Michel Henry
**À propos de... l’optique astronomique
par Gérard Oudenot
Petite
bibliographie SAF
par Hervé
Saint-Yves
Observer le ciel
Éclipse partielle
du 3 octobre 2005
par Marie-Claude
Paskoff
Comment observer
une éclipse avec un Solarscope
par Jean Gay
Croissants de
Soleil sous les arbres
par Mireille
Hartmann
Mais aussi
Le dix-milième
visiteur au coronographe par Jacques-Clair Noëns
Éphémérides
d’octobre 2005 2005
@stronet par
Jean-Pierre Martin
Cadrans solaires
(30) par Alain Ferreira

C'est tout pour
aujourd'hui!!
Bon ciel à tous!
JEAN PIERRE MARTIN
Astronews
précédentes : ICI
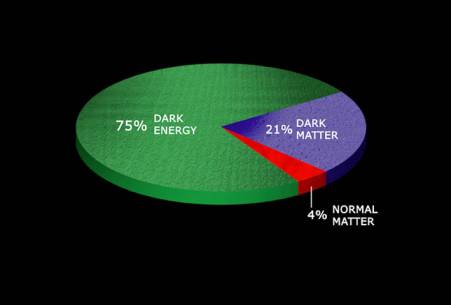 Nous
(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et
galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,
triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on
appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons
neutrons électrons).
Nous
(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et
galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,
triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on
appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons
neutrons électrons).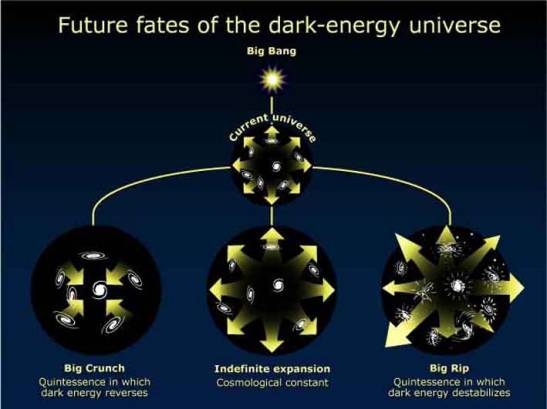 La base de cette mission est une sonde
appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer
entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre
plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit
continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big
Crunch).
La base de cette mission est une sonde
appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer
entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre
plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit
continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big
Crunch).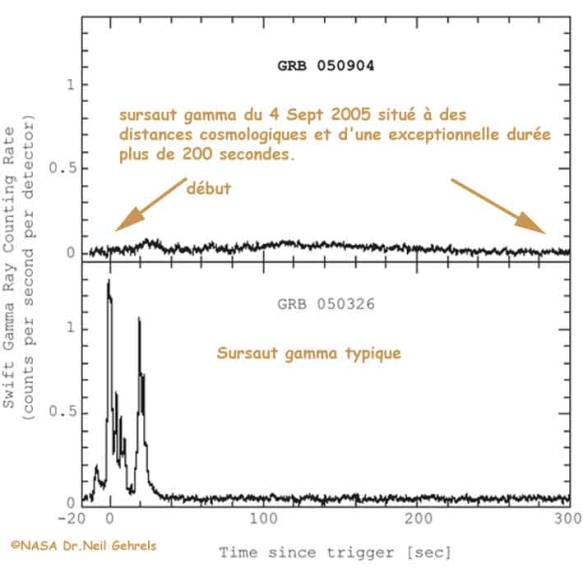 L'intérêt
de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances
cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.
L'intérêt
de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances
cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.