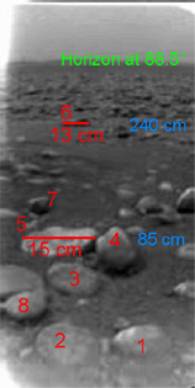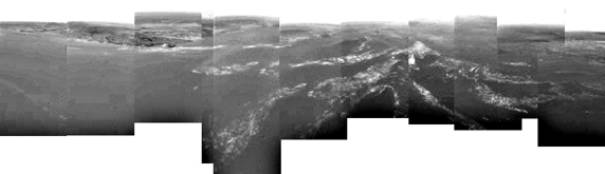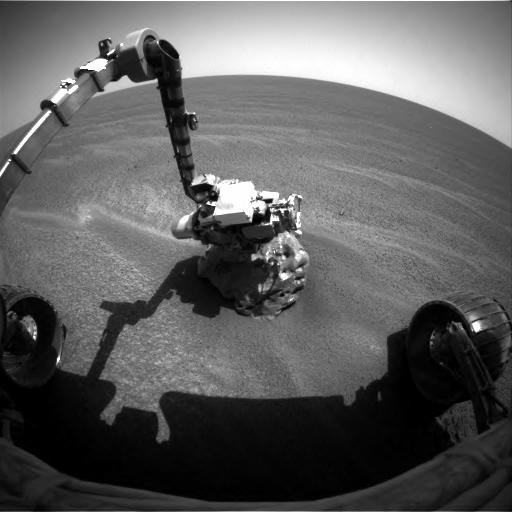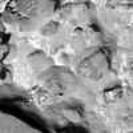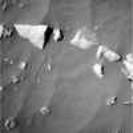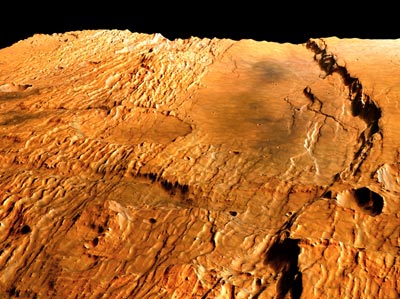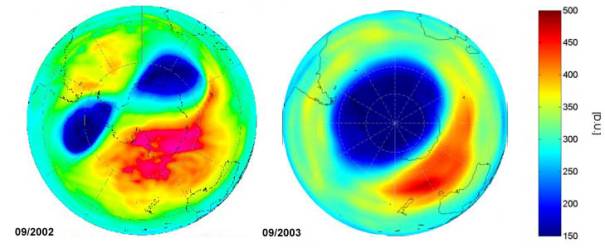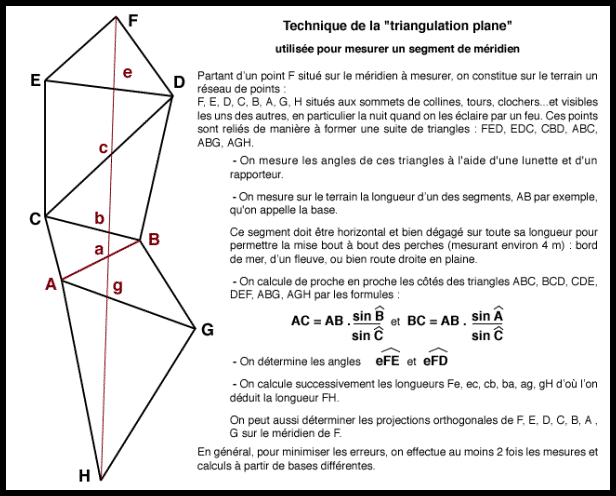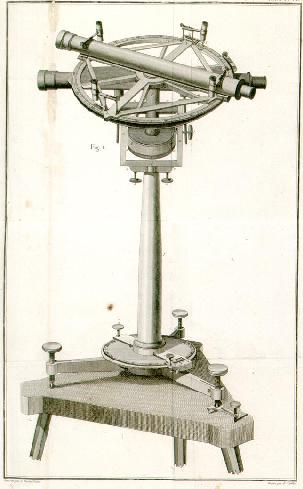David Southwood
ESA’s Director of Science Programmes
Jean-Pierre
Lebreton
ESA’s Huygens Project Scientist and Mission Manager
Marcello Fulchignoni (TBC)
Principal Investigator for the Huygens Atmospheric Structure Instrument (HASI),
from the University of Paris/Observatoire de Paris-Meudon, France
Martin G. Tomasko
Principal Investigator for the Descent Imager and Spectral Radiometer (DISR),
from the University of Arizona in Tucson, United States
John C. Zarnecki
Principal Investigator for the Surface Science Package (SSP), from the Open
University at Milton Keynes, United Kingdom
Guy
Israel
Principal Investigator for Aerosol Collector and Pyroliser (ACP), from CNRS,
Service d’Aéronomie, Verrières-le-Buisson, France
Toby Owen
Cassini Interdisciplinary Scientist for the atmospheres of Titan and Saturn,
from the Institute for Astronomy, Honolulu, United States
 Ce
qu'il faut en retenir
Ce
qu'il faut en retenir
C'est David
Southwood qui fait l'introduction de cette conférence de presse qui a lieu dans
les locaux de l'ESA à Paris.
Il est à remarquer
que cette conférence de presse a eu lieu totalement en anglais et que nos
scientifiques ont très correctement parlé la langue de Shakespeare ce qui
n'était pas toujours le cas il y a quelques années!
 Il
passe la parole au papa de Huygens Jean Pierre
Lebreton.
Il
passe la parole au papa de Huygens Jean Pierre
Lebreton.
Il confirme que
l'on s'est posé à l'endroit le plus froid du système solaire où on n'a jamais
été : 94°K ou –179°C.
Avec maintenant
une semaine de recul, on a une nouvelle approche des données. (a new
understanding of the data is emerging)
Suivent des
détails techniques de la descente qui sont maintenant connus, justement cette
descente était plus rude (bumpier!) qu'on l'avait imaginé.
Il revient sur les
fameux canaux de transmission (A et B, le A étant tombé en panne), le A est
bien tombé en panne car son horloge n'avait pas été déclenchée correctement;
mais que grâce à une expérimentation très hardie, certains radio télescopes
terrestres dont le VLBA (Very Large Base Array) ont sauvé toutes les données de
ce fameux canal. Tout a été récupéré (everything has been recovered!!).
Puis description
de l'exact timing de la descente qui se trouve sur le site de l'ESA.
Marti Tomasko (Descent
Imager-Spectral Radiometer DISR)
prend le relais et nous commente un jeu de photos qui ne sont pas réellement
nouvelles (voir les photos plus haut dans ce texte) mais dont les explications
le sont : il y a bien des chenaux d'écoulement de
liquide, le sol semblant être de la glace d'eau,
de la matière organique se trouve dans le fond de ces chenaux; un liquide a
bien coulé.
À propos de la
photo de la surface, on remarque que ces "pierres" sont plutôt des
morceaux de glace et sont arrondis et qu'une certaine érosion a joué. Le sol est composé de
"dirty water ice rocks" (rochers de glace sales)
Il y a donc et il
conclut la dessus; des évidences géologiques de précipitations, d'érosion et
d'autres activités fluviales conduisent à penser que des phénomènes similaires
à ceux qui ont formés la Terre sont aussi en action sur Titan. Bref des
processus communs avec notre planète.
Toby
Owen, est responsable des expériences atmosphériques, c'est lui le
"nez" de la mission si j'ose dire.
Il confirme la présence importante de méthane (CH4) sur Titan, mais
on ne sait pas expliquer pourquoi, car le méthane se détruit naturellement en
quelques siècles, il ne devrait plus y en avoir, alors c'est un problème
(Puzzle comme disent nos amis britanniques).
Il y a donc une
source de méthane sur Titan et il fait trop froid pour les vaches alors….
Tobi nous a même
expliqué que le spectromètre de masse a mesuré le taux de CH4 pendant la
descente et confirme qu'en arrivant au sol la concentration augmente, cela ne
peut que provenir du sol.
Mais le point le
plus spectaculaire est qu'il nous indique qu'il pleut
certainement sur Titan (de la pluie de méthane bien sûr), cela est même
arrivé hier comme il dit.
En fait Tobi Owens
a une très belle image : c'est une planète inflammable
!! (it is a flammable world).
La force fournie à
l'atterrissage a été étudiée par John Zarnecki et il
nous montre même (désolé les photos faites à l'écran sont de très mauvaise
qualité, donc je ne vous les passe pas) un capteur de force (force transducer)
similaire à celui sur Huygens, les mesures et les simulations faites dans son
labo après coup l'ont conduit à décrire la surface (qui était assimilée à du sable
dur) comme un sable de billes de verre avec pour expliquer le "crac"
à l'arrivée, une croûte à base d'une plaque de verre.
Les accéléromètres
ont montré une enfoncement de 10cm dans le sol.
Le Professeur
Zarnecki confirme aussi la présence de CH4, on s'en est aperçut en fait lorsque
la sonde était posée, un jeu de "chaufferettes" a chauffé le sol
autour de celle-ci et fait s'évaporer les corps volatils qui ont été mesurés
par le Spetro de masse (GCMS),
de même le SSP (Surface
Science Package) l'a aussi reniflé.
JP Lebreton
conclue cette aventure fascinante :
Du méthane liquide coule sur Titan
Il pleut certains jours sur Titan
Le méthane joue le rôle qu'a joué l'eau
sur Terre
Les roches de glace jouent le rôle des
roches silicates de la Terre.
La poussière est à base de matière
organique.
On doit continuer le travail et de
rêver d'un petit rover sur Titan en disant que c'est dans les choses possibles
mais money money !!!
Remerciements à
Alactel qui a construit l'engin et au JPL pour l'extrême bonne coopération.
David Southwood y
va aussi de sa conclusion à l'adresse de nos amis américains :
"We are in the exploration business too!!!" (nous sommes aussi dans l'exploration
spatiale, c'est à dire qu'il faut compter avec nous, les européens).
Le rapport par
l'ESA de cette conférence a été mis en ligne, vous le trouverez en anglais ICI.
Bravo à tous.
Dernières infos
sur Titan Huygens
Voir le site de
l'ESA : http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/
Et sa galerie
de photos de titan.
Excellent rapport
en anglais chez nos amis de la Planetary
Society.

CASSINI SATURNE :
(Photos NASA/JPL)
Au moment de sa
mise en orbite périlleuse au mois de Juillet 2004 (on est passé entre les
anneaux Fet G), on sait maintenant qu'il a été pris dans une tempête de
particules, comme indiqué dans un rapport publié récemment dans Nature par
Sascha Kempf du Max Planck Institute for Nuclear Physics de Heidelberg, Germany
Les minuscules
grains impactèrent Cassini à plus de 100km/s, l'auteur pense que ces particules
proviennent soit de l'anneau A soit de l'anneau E. il ne faut pas être étonné
par de telles vitesses, en effet dans l'espace il n'y a pas de frottement,
c'est le vide presque absolu.
Ces impacts
devinrent de plus en plus fréquent au fur et à mesure que la sonde s'approchait
de Saturne.
On pense qu'ils
sont composés de minuscules cristaux de glace chargés positivement et accélérés
par l'énorme champ magnétique de Saturne.
Comme d'habitude,
vous trouverez toutes les dernières
images de Cassini au JPL:

LES ROVERS MARTIENS
:ON AVAIT RAISON POUR LA MÉTÉORITE!
(Photos NASA/JPL)
N'oublions pas nos
deux petits robots courageux à la surface de Mars.
Vous vous souvenez
il y a une dizaine de jours, je
vous signalais sur une photo d'Opportunity près des débris du bouclier
thermique, une pierre un peu bizarre de taille grosse comme un ballon de
football . Cela semblait ressembler à une météorite.
 La
NASA fournit une photo en couleur de cette "pierre".
La
NASA fournit une photo en couleur de cette "pierre".
Elle a quand même
paru bizarre aussi aux techniciens US et ils ont décidé de l'analyser.
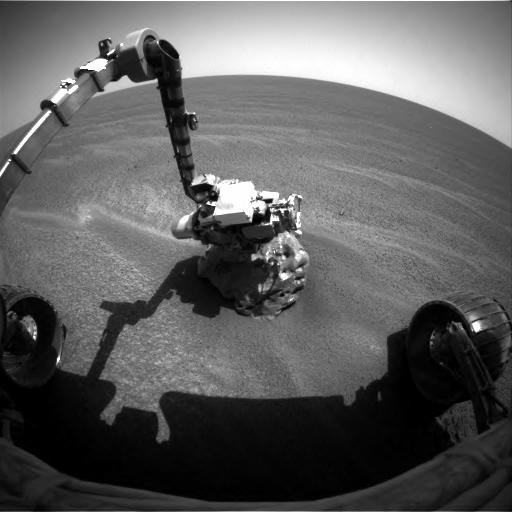 On
a donc décidé de l'examiner avec le bras robotisé.
On
a donc décidé de l'examiner avec le bras robotisé.
(voir photo)
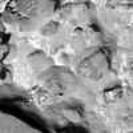
Vue de près de
cette météorite
(clic sur l'image pour la voir en grand)
 Vue
au microscope situé au bout du bras d'Opportunity d'une partie de la météorite
Vue
au microscope situé au bout du bras d'Opportunity d'une partie de la météorite
(clic pour voir en
grand)
Et bien la NASA
vient de le confirmer, elle a envoyé le robot y faire quelques analyses avec le
spectromètre Mössbauer et le mini
TES, et c'est une…..météorite ferrique.
Le spectromètre en
rapport la composition : Nickel et Fer.
Elle a été
baptisée pour la presse "heat shield rock".
L'aspect très
brillant de la météorite intrigue ainsi que l'absence de cratère d'impact,
certains pensent qu'elle aurait atterrit à cet endroit à l'époque où
l'atmosphère martienne était plus dense ce qui expliquerait cela.
Steve Squyres le
père de la mission n'aurait jamais pensé trouver sur Mars par Opportunity un
morceau venant d'autre part.
Opportunity vient
d'accomplir ses 2100m sur Mars dans Meridianum Planum.

LES ROVERS MARTIENS
:SPIRIT CONTINUE!
(Photos NASA/JPL)
De l'autre coté de
Mars, Spirit continue lentement son ascension vers le sommet Husband Hill.
Les terrains sont
toujours aussi désertiques comme le prouvent ces quelques photos.
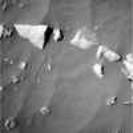
Spirit sol 367.

Spirit sol 368.
Les meilleures
photos sont classées dans le planetary photojournal que vous pouvez retrouver à
tout instant:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Mars

MARS EXPRESS :
CLARITAS FOSSAE EN DETAIL
(Photos et
graphiques : ESA)
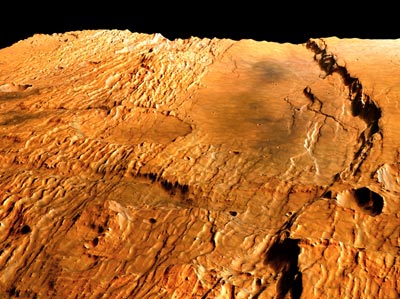 L'ESA avec sa sonde Mars Express continue
son périple autour de la planète Mars.
L'ESA avec sa sonde Mars Express continue
son périple autour de la planète Mars.
Elle vient de
prendre en détail la région Claritas Fossae et publie un compte
rendu avec tous les types de photos à ce sujet (relief, 3D, oblique, noir
et blanc)
Vous voulez tout
savoir sur la nomenclature martienne car vous avez perdu votre latin, qu'à cela
ne tienne, Philippe Labrot le génial créateur de Nirgal.net (Nirgal est le nom
babylonien de Mars) vous
explique tout.

TERRE : ATTENTION
COLLISION D'ICEBERGS
(Photos ESA)
Nous avons déjà
parlé il y a quelques temps du problème de la banquise antarctique qui se
désagrège.
Et bien cela
continue et pas un petit morceau!!

L'ESA vient de
publier un communiqué
de presse sur le sujet pris en flagrant délit par son satellite ENVISAT.
On voit
parfaitement le morceau appelé B-15-A qui apparemment va entrer en collision
avec la banquise appelée Drygalski Ice Tongue (langue de glace de Drygalski)
Cet objet flottant
B-15-A est le plus gros objet flottant du monde, il est de la taille du
….Luxembourg et a la forme d'une bouteille (enfin il faut avoir aussi goûté à
la dive bouteille pour imaginer cela, mais enfin..).
Il fait 120km de
long, et est en train de bloquer les courants dans la baie conduisant au gel de
cette partie de mer, et cela met en danger une population de ….pingouins!
Envisat suit
l'évolution de cet iceberg depuis plus de deux ans et l'on peut voir sur leur
site une intéressante animation.
Envisat
(Environmental Satellite) a été lancé en Mars 2002,c'est le programme européen
le plus important jamais conçu pour surveiller l’état de notre planète et
l’impact de nos activités. Le satellite fournit quotidiennement une richesse
d’informations sans précédents sur notre planète, permettant d’étudier avec
précision l’évolution des phénomènes environnementaux.
Son but
est aussi de veiller à la couche d'ozone
: (d'après documents CNES) :
La couche d’ozone
est une barrière protectrice contre les rayons UV du soleil, située dans la
stratosphère, à une hauteur comprise entre 25 et 35 km au-dessus de nos têtes.
Son importance est vitale car elle nous protège des brûlures et cancers de la
peau.
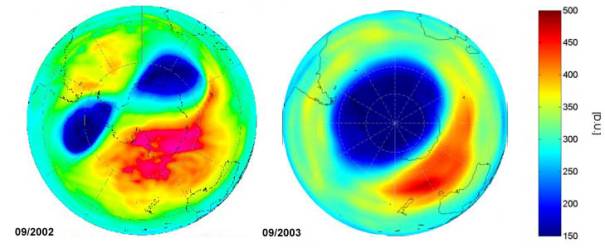 Or,
les symptômes sont formels : la couche d’ozone est malade,
parsemée de multiples « trous ». Les gaz à effet de serre, à l’origine de
l’activation des chlores destructeurs d’ozone, sont les premiers ennemis de
notre atmosphère.
Or,
les symptômes sont formels : la couche d’ozone est malade,
parsemée de multiples « trous ». Les gaz à effet de serre, à l’origine de
l’activation des chlores destructeurs d’ozone, sont les premiers ennemis de
notre atmosphère.
photo de gauche :
Évolution du trou de la couche d'ozone entre septembre 2002, observé par
l'instrument GOME à bord d'ERS-2, et septembre 2003, par l'instrument MIPAS à
bord d'ENVISAT. Crédits: BIRA-IASB
Les nouvelles réglementations internationales doivent permettre une diminution
de ces espèces chlorées mais un retour à la normale n’est toutefois pas prévu
avant le milieu du siècle…
Les mesures réalisées par ENVISAT permettront de vérifier le respect des
accords internationaux et de préparer les prochaines avancées réglementaires
dans ce domaine.
Et aussi
comprendre la dynamique des océans
:
Les océans sont le
lieu privilégié d’échanges de chaleur importants avec l’atmosphère. Ces
échanges régulent les changements climatiques. Ils peuvent également, dans
certains cas, jouer un rôle perturbateur
L’observation
depuis l’espace, en particulier avec les satellites d’altimétrie
franco-américains TOPEX-POSEIDON et JASON-1, a levé le voile sur des phénomènes
d’une grande complexité. L’exemple le plus connu est le phénomène El Nino dont
les effets se font ressentir sur l’ensemble de la planète, par des sécheresses
ou des pluies abondantes localisées.
ENVISAT, grâce à sa capacité d’observation à  petite
échelle, permet de compléter le dispositif d’analyse et de modélisation du
comportement des océans. Température, couleur de l’eau, vitesse et direction
des vents, courants… Les océans n’auront à court terme plus de secret pour les
chercheurs.
petite
échelle, permet de compléter le dispositif d’analyse et de modélisation du
comportement des océans. Température, couleur de l’eau, vitesse et direction
des vents, courants… Les océans n’auront à court terme plus de secret pour les
chercheurs.
Envisat est le
plus gros satellite lancé par l'Europe. (8200kg).
Sur la photo on se
rencontre de la taille énorme de ce satellite qui a nécessité une fusée Ariane
5 pour son lancement.
Les instruments à
bord d'Envisat : (bonne
description en français par nos amis de Spacenews).
|
ASAR MERIS
|
Radar pour l’observation des terres
émergées, des océans et des calottes polaires
|
|
MERIS
|
Spectromètre à résolution moyenne conçu pour
l’observation de la couleur des océans. Il permet de détecter les
concentrations en phytoplancton ou bien encore les pollutions marines
|
|
RA-2
|
Altimètre
radar permettant
d’étudier en continu la topographie de la surface des océans, des terres
émergées et des calottes polaires
|
|
GOMOS
|
Instrument de surveillance
de la couche d'ozone
|
|
MIPAS
|
Sondeur
atmosphérique permettant la cartographie des concentrations en gaz rares dans
la stratosphère et la troposphère
|
|
AATSR
|
Radiomètre permettant de mesurer la température à la
surface de la mer et des continents et d’étudier la croissance de la
végétation, l’humidité des sols et la composition des nuages
|
|
DORIS
|
Système de
navigation permettant de déterminer avec une précision exceptionnelle -
3 cm pour ENVISAT - la position du satellite sur son orbite
|
|
SCIAMACHY
|
Spectromètre
détectant les gaz rares dans la troposphère et la stratosphère
|
|
LLR
|
Réflecteur laser
permettant de déterminer précisément l’orbite d’un satellite grâce à des tirs
laser à partir de stations terrestres
|
|
MWR
|
Radiomètre à
hyperfréquence permettant d’évaluer la quantité de vapeur d’eau dans la
troposphère
|
Vue de la
pollution terrestre globale et article correspondant
et tout sur le spectromètre SCIAMACHY.

TERRE : LE TSUNAMI VU DE
L'ESPACE
La NASA met en
ligne des images
impressionnantes du Tsunami de Noël 2004 vu de l'espace et dans le style :
avant et après.
Il y a parmi
celles ci aussi des animations pas trop lourdes en MB que vous pouvez
télécharger.
Allez les voir, on
est peu de chose!

TERRE : DES AURORES !
Trouvé par notre
ami Belge de Anvers Raoul Lannoy de belles aurores sur le site de
Spaceweather.
 Voici
notamment une animation de Roman Krochuk disponible sur ce site, mais il y en a
bien d'autres.
Voici
notamment une animation de Roman Krochuk disponible sur ce site, mais il y en a
bien d'autres.

LIVRES CONSEILLÉS J'AI LU
POUR VOUS par Pascal Gérardin de VÉGA
Aujourd'hui, je
vous convie à une aventure intellectuelle et humaine des plus extraordinaire de
toute notre Histoire.
 L’invention
du mètre racontée dans le livre « Le mètre du monde » de Denis Guedj
se lit comme un vrai roman d’aventures émaillées de péripéties, de joies et de
drames, de doute et d’espoir qui, de l’aube de la Révolution française au coup
d’Etat du 18 Brumaire, retrace ce que fut la mesure de la Méridienne entre
Dunkerque et Barcelone par les astronomes Pierre Méchain et Jean-Baptiste
Delambre.
L’invention
du mètre racontée dans le livre « Le mètre du monde » de Denis Guedj
se lit comme un vrai roman d’aventures émaillées de péripéties, de joies et de
drames, de doute et d’espoir qui, de l’aube de la Révolution française au coup
d’Etat du 18 Brumaire, retrace ce que fut la mesure de la Méridienne entre
Dunkerque et Barcelone par les astronomes Pierre Méchain et Jean-Baptiste
Delambre.
L’auteur Denis Guedj est né en 1940, il est romancier et
mathématicien. Professeur d’histoire des sciences à
l’université Paris 8, il a écrit de nombreux ouvrages dont « La
Méridienne » et « Les cheveux de Bérénice » Il a été journaliste
à Libération et scénariste.
Le titre,
« Le mètre du monde », sous la forme d’un jeu de mots, est révélateur
de l’importance capitale de l’uniformisation des poids et des mesures. Le mètre est bien le maître des mesures et il est né de la
mesure du monde, c’est-à-dire la Terre elle-même, il est la dix
millionième partie du quart du méridien terrestre.
En astronomie, la
mesure des distances est essentielle pour nous situer dans l’espace. Très vite,
le mètre, invention à l’échelle terrestre, s’est révélé nettement insuffisant
pour mesurer l’univers. L’unité astronomique (UA)[1] a fait place à
l’année lumière (AL), la distance que parcourt la lumière en une année
terrestre.
Mais ne brûlons
pas les étapes et commençons par le commencement.
Déjà dans l’empire
romain, l’unification métrologique était une nécessité. A chaque effort pour
unifier l’Etat correspond la volonté de « réduction des mesures à une
seule façon » : l’époque carolingienne, la Renaissance, et le siècle
des Lumières. François Ier, Henri II, Louis XIV mais aussi Ivan le Terrible,
Pierre le Grand et Frédéric II
échouèrent dans leurs tentatives.
Enfin en 1789,
alors que près de 2000 mesures ont cours en France, la réunion des États
généraux et l’étude des cahiers de doléances puis la proclamation de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen vont déclencher une réforme
indispensable « à tous les hommes, à tous les temps »
Mais
quelle mesure choisir ?
Pourquoi en adopter une plus qu’une autre ? Il fallait faire table rase et
inventer une nouvelle mesure pour tous les peuples.
Condorcet,
Talleyrand et Prieur furent à l’origine du début d’une véritable épopée
métrologique. Bientôt deux astronomes, Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre
puis un physicien, le chevalier de Borda les remplaceront.
Aux anciennes
mesures locales et éphémères, se substituerons celles tirées de la nature, invariables et universelles.
Au début les
scientifiques étaient partagés entre deux bases pouvant servir à une mesure
universelle : le pendule et la Terre.
Avec le pendule,
une durée de l’oscillation d’une seconde détermine une longueur de fil. Mais
l’astronome Jean Richer observa que les mouvements du pendule étaient
différents sous certaines latitudes.
La rotondité de la
Terre étant immuable, on s’orienta donc vers le choix d’une mesure terrestre.
Mais, le 8 mai
1790, l’Assemblée nationale décréta qu’elle choisissait le pendule. Talleyrand,
évêque d’Autun, l’avait également proposé et en fût l’ardent défenseur.
Cependant, pour des raisons politiques, l’accord de l’Angleterre était
indispensable. La réponse tomba le 3 décembre 1790, la perfide Albion refusait,
pour des raisons obscures, la proposition française.
Puis ce fût le
coup de théâtre du 16 février 1791 en la personne du physicien et marin Jean
Charles Borda qui proposa de nommer une commission. Composée de Borda, Lagrange, Monge, Laplace et Condorcet, elle
accepta le méridien comme base du nouveau système.
Talleyrand se
rangea à son côté.
En somme, le
pendule n’était pas assez précis et sa mesure pas assez universelle. De plus
les scientifiques étaient très divisés.
L’unité
allait donc être la Terre elle-même
et plus justement le méridien parce que chaque peuple appartient à un des
méridiens du globe. Etant exclu de mesurer l’ensemble, la Méridienne de
Dunkerque à Barcelone s’imposait parce que son arc était en partie connu et
binational.
Les premières
mesures de la Terre eurent lieu dès l’Antiquité où le grand méridien était
« l’axe du monde » de Byzance à Méroé en Ethiopie. La véritable
mesure du tour du globe est celle d’Eratosthène au IIIème siècle avant notre
ère qui affiche un résultat étonnant de précision pour l’époque, 250 000
stades, c’est-à-dire 39 375 km (réellement 40 000,03 km)
En Occident, le
médecin Jean Fernel en 1525 détermine en tours de roues la distance Paris
Amiens sur un même méridien. Puis le Hollandais Snellius invente la méthode de
la triangulation qui fût celle utilisée dans la mesure de la Méridienne.
Il était question
de cartographier la France et la famille Cassini y contribua beaucoup. Toutes
les mesures effectuées jusqu’en 1718 démontraient que notre globe était allongé
aux pôles !
Ces mesures loin
d’être précises furent reprises par l’abbé La Caille aidé par Cassini de Thury
(Cassini III) qui établirent définitivement en 1744 que notre Terre est aplatie
aux pôles.
Il était donc
question de reprendre tout à zéro, avec des instruments plus précis, sur une
plus longue distance et en y consacrant beaucoup d’argent. Une vraie Révolution
s’engageait pour emprunter la voie la plus ambitieuse. Créer une nouvelle
mesure en adoptant l’unité méridien et en refaisant les mesures de la
Méridienne.
Après une année
d’attente afin de préparer les instruments et après trois défections des
membres des commissions, le départ de l’opération est donné dans la cour des
Tuileries le 25 juin 1792.
L’astronome Pierre Méchain mesurera la Méridienne de Barcelone à Rodez.
Cet observateur
hors pair, patient et minutieux, naît le 16 août 1744 à Laon. Il est
hydrographe, découvreur d’une dizaine de comètes et il sait harmoniser les
beautés du ciel et des mathématiques.
Jean-Baptiste
Delambre se chargera de la
mesure de Dunkerque à Rodez.
Il naît à Amiens
en 1749, littéraire, polyglotte, il est doué d’une mémoire hors du commun.
Initié à l’astronomie par Lalande, il établit les tables d’Uranus, du Soleil,
de Saturne, de Jupiter et de ses satellites.
Ces deux
astronomes et leurs assistants utiliseront la méthode de la triangulation qui
consiste à mesurer du linéaire par de l’angulaire, « si on connaît deux
angles et un côté d’un triangle, on connaît tous les côtés », donc une
seule mesure linéaire (celle de la base) et une série de mesures angulaires.
Appendice : rappel
de la triangulation.
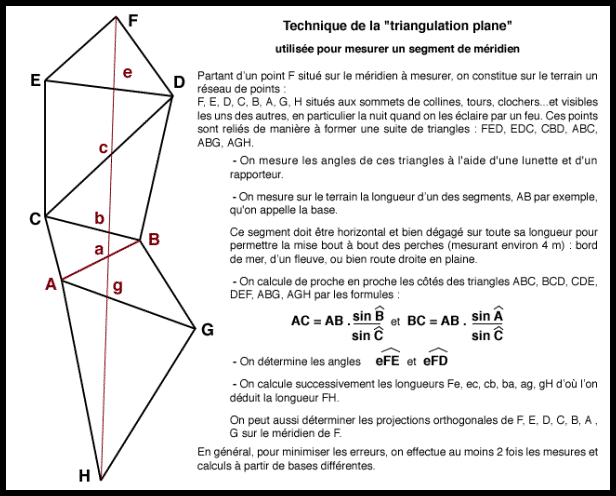
L’épopée
géodésique commence et va durer près de sept longues
années.
En effet, les
débuts sont laborieux. Il faut des repères précis pour effectuer la triangulation. Un signal est nécessaire comme un
clocher, une montagne, un château d’eau ou une tour. Ces signaux utilisés lors
des précédentes campagnes de mesures sont défectueux ou n’existent plus dans la
partie Nord. De plus, c’est la guerre, l’armée prussienne passe la frontière,
« la patrie est en danger »
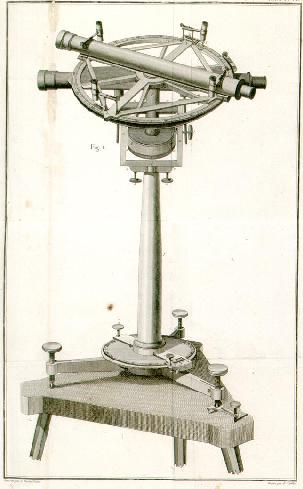 La
population est très méfiante et ne facilite pas le travail de mesure. Mais
c’est la victoire de Valmy, l’exécution de Louis XVI et les Tuileries en feu.
L’An I de la république française est proclamé, l’Histoire est en marche.
La
population est très méfiante et ne facilite pas le travail de mesure. Mais
c’est la victoire de Valmy, l’exécution de Louis XVI et les Tuileries en feu.
L’An I de la république française est proclamé, l’Histoire est en marche.
Seul l’astronome
Méchain progresse à grands pas en Espagne mais la situation se dégrade et les
flammes de la guerre embrasent les deux extrémités de la Méridienne.
La Convention
s’impatiente, les mesures sont trop lentes. Un mètre
provisoire est créé. La mesure de la Méridienne est très compromise, car
un malheur n’arrivant jamais seul, Méchain se blesse gravement dans un accident
et après un coma reste handicapé plusieurs mois. Les guerres font rage et la
guillotine de la Révolution assassine aussi les hommes de science. Enfin,
catastrophe, la Convention décrète la division décimale du temps. Le jour est
divisé en 10 heures de 100 minutes, etc. Même le pendule ne bat plus la même
seconde.
Tous ces obstacles
paraissent insurmontables et pourtant nos deux
courageux astronomes progressent sûrement.
Mais début 1794,
le Comité de salut public destitue la plupart des membres de la Commission des
poids et mesures, dont Borda et Delambre. Méchain n’est pas concerné. Ce coup
de théâtre n’arrange rien car entre temps, Condorcet s’est suicidé, Lavoisier a
été guillotiné. L’opération de mesures est suspendue.
Quant à la copie
du mètre provisoire qui devait rejoindre les États Unis d’Amérique, elle n’y
arrivera jamais. Le bateau du botaniste Dombey sombre après une attaque des
pirates. Fait prisonnier, il est emporté par une épidémie.
Heureusement, les
soldats de l’An II ont vaincu les armées étrangères qui menaçaient la jeune
République.
La
campagne de mesures reprend
entre Orléans et la frontière espagnole.
En 1795, Prieur,
membre de la Convention fait adopter le système métrique. Son Rapport est
l’acte de naissance de l’ensemble des nouveaux poids et mesures et instaure le
système métrique décimal (le SMD) Ce mètre sera tracé sur une règle de platine
et aura pour nom le « mètre républicain » Surface, volume et masse,
définis à partir du mètre, seront liés. La géométrie suffit pour les deux
premières, c’est l’eau qui servira à la troisième. Le socle du système est le
triptyque Terre, Dix et Eau puis l’unité de monnaie, le franc.
Ensuite,
la question était de savoir comment nommer ces mesures ?
On devait forger
des mots entièrement nouveaux et universels. Effectivement le mot mètre est d’origine latine (metrum) et grec (metron)
Les noms des mesures sont chargés d’informer sur les mesures qu’ils nomment. Il
y aura trois mots-racines : mètre (mesure
linéaire), litre (mesure de capacité), gramme (mesure de poids) et l’ajout de stère et are,
puis des mots-préfixes : latins pour les sous-divisions (milli, centi,
déci) grecs pour les multiples (déca, hecto, kilo, myria)
Pas de
jaloux !
De plus de mille
noms, nous passons à « douze petits mots » !
Deuxième unité
fondamentale du système métrique, l’unité de masse
fait intervenir une matière universelle, tirée de la nature et
invariable : l’eau.
Une eau distillée
à la température de la glace fondante, c’est-à-dire 5° centigrades. Restait à
trouver le contenant. On choisit de construire un cylindre droit en laiton dont
la hauteur est égale au diamètre de la base et d’un volume de 1 dm3.
Enfin, le 7 avril
1795, la Convention autorise la poursuite de la mesure de la Méridienne.
Méchain, absent de France depuis trois ans, était bloqué en Italie. Il reprend
l’opération de mesure près de Perpignan. Delambre descend vers le sud entre la
Loire et Bourges.
Le 25 juin 1795, l’abbé Grégoire propose la création du Bureau des longitudes.
La mesure de la
Méridienne est toujours aussi laborieuse. De nombreux signaux sont
inutilisables et le budget se réduit de jour en jour. Un seul clocher détruit
par la Révolution et c’est un pan entier de la triangulation qu’il faut
rebâtir.
Fin 1796, alors
que Bonaparte combat en Italie, il reste à Méchain neuf stations à conquérir et
douze à Delambre.
Parallèlement, il
faut fabriquer et populariser le mètre. La fonte, le fer, le plomb et le cuivre
du métal des cloches sont utilisés, mais également le chêne, le buis et le
noyer. Nombre de métiers produiront et diffuseront les nouvelles mesures tandis
que tous les citoyens de bonne volonté informeront et éduqueront la population,
en attendant le mètre définitif.
Chargé d’une
double mission éducatrice et libératrice, le mètre va bouleverser les habitudes
de la jeune République.
Delambre améliore
les triangles des départements de l’Aude et du Tarn. Par peur, les populations
détruisent parfois les signaux qu’il faut reconstruire sans cesse. Le moral et
la santé de l’astronome sont mis à mal. Après des mois d’aventures, Delambre
atteint enfin Rodez et le dernier signal surmonté d’une Vierge en pierre.
Six années pour
aller de Dunkerque à Rodez.
Deux bases restent
à mesurer : Melun et Perpignan,
chacune longue de 12 km et distante de 700 km. Unique mesure linéaire, elle
constitue l’échelle de la triangulation effectuée à l’aide de quatre règles de
platine et dure jusqu’au 4 juin 1798.
Enfin, les deux
astronomes Delambre et Méchain se retrouvent après six années de séparation.
Ils arrivent à
Paris fin novembre 1798.
Le système
métrique décimal ayant un dessein universel et devant être adopté par toutes
les nations, une Commission internationale est créée afin de vérifier les
mesures et de s’en porter garante devant le monde. Durant trois mois les
commissaires vont tout analyser et vérifier des opérations et des expériences
réalisées.
La chaîne totale
comporte 115 triangles et la mesure est étonnante de
précision : dix mètres d’écart sur plus de 1 000 km entre celle de
Delambre, Méchain et la référence internationale de 1980 !
Et plus étonnant
encore, le mètre temporaire s’avère plus proche de la mesure actuelle que le
mètre définitif.
La production du
mètre et du kilogramme étalon est exécutée en platine, métal le plus précieux
et le plus rare de l’époque, plus onéreux que l’or.
Le 22 juin 1799,
jour du solstice d’été (la République a été proclamée le jour de l’équinoxe
d’hiver, l’astronomie, ici encore, est au rendez-vous !) le président de
la Commission internationale, M. Van Swinden, annonce la fin des travaux de
mesures et déclare que nous possédons à présent le mètre de la nature et le kilogramme
vrai et qu’ils seront conservés aux Archives de la République.
Il y a beaucoup de
grands absents, même Borda n’a pas eu la force d’attendre, il s’est éteint
quelques mois plus tôt.
Quelques temps
après, le coup d’Etat du 18 Brumaire place le général Bonaparte au pouvoir.
Le 15 décembre
1799, la République est morte, le Consulat commence…
La Révolution n’a
pas seulement unifié les poids et les mesures, elle a unifié l’espace avec la
départementalisation, le temps avec le calendrier républicain et la langue. Le
nouveau calendrier n’a pas survécu à la Révolution, il n’y aura pas d’an XVI…
Pour le reste, c’est plutôt une réussite même si, pour la langue, les parlers
régionaux subsistent et c’est tant mieux.
Diverses
péripéties ont émaillé la mise en œuvre du système métrique. Dès 1800, le
Consulat n’en a gardé que le mètre, les mesures napoléones remplacèrent les mesures républicaines.
Louis XVIII
abandonne le système métrique décimal qui réapparaît en 1840. Progressivement,
les pays d’Europe l’adoptent mais il faudra attendre 1985 pour que les
Britanniques acceptent le mètre et le kilogramme au même titre que le yard et
la livre.
Le 28 septembre
1889, à l’orée du parc de St Cloud, le pavillon de Breteuil accueille le mètre
international et le kilogramme international en platine iridié, alliage de 90 %
de platine et 10 % d’iridium.
Le 14 octobre
1960, le « mètre optique » défini comme « 1 650 763,73 longueurs
d’onde dans le vide de la radiation orangée du krypton 86 »
Puis nous sautons
du vide à la lumière, le 20 octobre 1983, le mètre devient « la longueur
parcourue dans le vide par la lumière durant la durée de 1/299 792 458
seconde »
En deux siècles,
on est passé de la mesure des Lumières à la lumière comme mesure.
C’est ainsi que
s’achève l’extraordinaire histoire de l’invention du mètre, du moins pour
l’instant…
J’ai lu ce livre
avec un réel plaisir et une curiosité jamais rassasiée, je l’ai parcouru comme
un roman d’aventures où l’Histoire dépasse encore une fois l’imagination la
plus débridée.
Denis Guedj est un
mathématicien et un écrivain exceptionnel dans la clarté et la simplicité de
ses récits. Il raconte les mathématiques comme on parle de la beauté du monde.
Il a
merveilleusement narré la vie de ces hommes qui ont mesuré la Terre pour
définir l’étalon universel de toutes les mesures et pour qu’elle devienne LA
MESURE.
Ces
scientifiques ont fait passer la mesure de la Terre à la Terre comme mesure.
Il s’est passé en
métrologie ce qui s‘est passé en astronomie : de la même façon que la
Terre a été chassée du centre du monde physique au XVI ème siècle, l’homme l’a
été du centre du monde de la mesure au XVIII ème siècle.
Le système
métrique est le dénominateur commun qui relie les différentes mesures entre
elles et les hommes entre eux. Plus besoin de tables de conversion pour que
l’échange ait lieu ! Il est désormais direct et immédiat. Le système
métrique décimal est devenu la langue « maternelle » de l’échange
quantitatif.
La
Révolution française a offert le mètre au monde apportant l’unité là où régnait
la confusion (700 à 800 noms)
mais pourtant quelle perte dans la langue, que de mots disparus !
L’uniformité a
effacé à jamais la diversité de l’imaginaire des hommes et même, il faut le
dire, d’une certaine poésie. C’est une pensée à méditer…
Le système
métrique a unit les hommes, s’il pouvait faire naître la Paix universelle et
éternelle…
Bonne lecture à
toutes et à tous.
Renseignement sur
ce livre à
la FNAC : existe en livre de poche.
En complément : l'histoire du mètre.

C'est tout pour
aujourd'hui!!
Bon ciel à tous!
JEAN PIERRE MARTIN
Astronews
précédentes : ICI
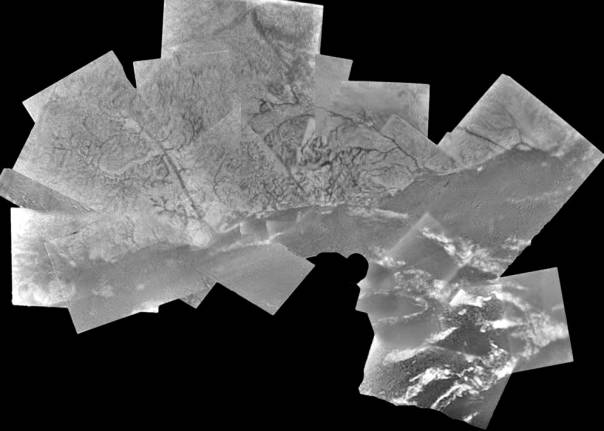
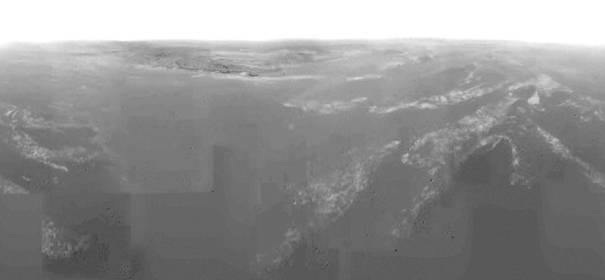
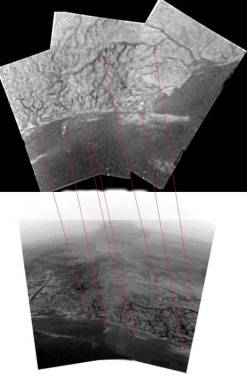
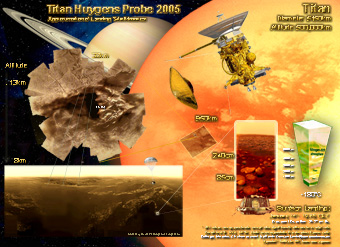 Il
y a notamment un
poster (2MB) qui résume la position des photos prises qui vaut le coup
d'être imprimé, il a été crée aussi par Kevin Dawson du Canada. Bravo!
Il
y a notamment un
poster (2MB) qui résume la position des photos prises qui vaut le coup
d'être imprimé, il a été crée aussi par Kevin Dawson du Canada. Bravo! Photo
: ESA-P. SEBIROT
Photo
: ESA-P. SEBIROT